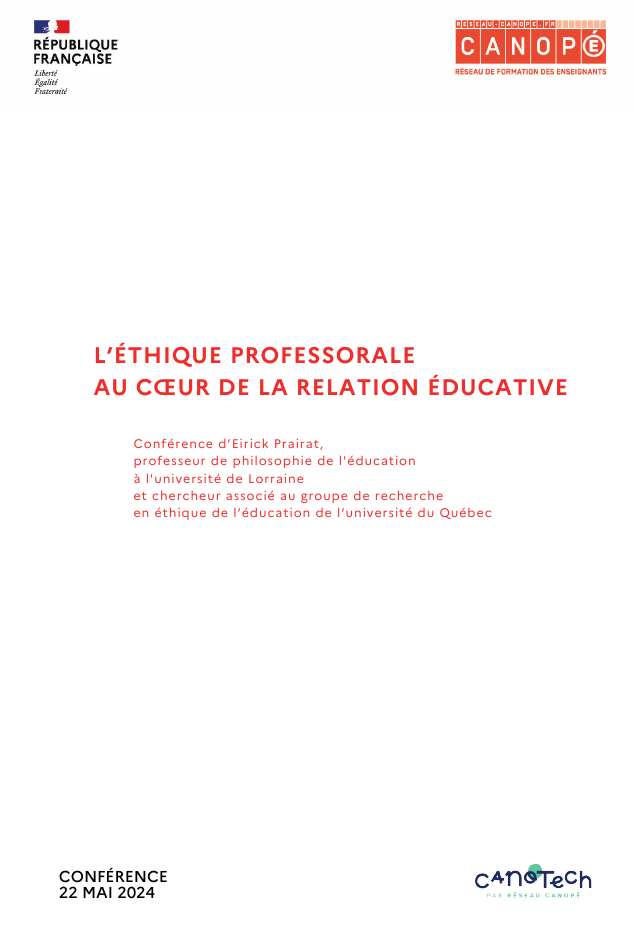
RÉSUMÉ
ESTIME DE SOI ET RÔLE DE L’ÉCOLE
Eirick Prairat, dans sa conférence, s'inspire des philosophes Paul Ricœur et Alain pour discuter de l’estime de soi, qui se construit à travers nos actions et est intrinsèquement liée à notre humanité commune. L’école joue un rôle central dans cette construction en valorisant les actions des élèves plutôt que leur identité.
JUSTICE, BIENVEILLANCE ET TACT
Eirick Prairat souligne que la première vertu d’un enseignant est la justice, qui combine respect des lois d’une part et, d’autre part, égalité des attentes en même temps qu’inégalité des
soutiens adaptés aux besoins des élèves. À cette justice, doivent s’ajouter la bienveillance, qui implique de prendre soin des élèves avec attention et sensibilité, et le tact, une vertu peu reconnue mais essentielle dans l’enseignement, qui consiste en un sens de l’à-propos et de la sensibilité relationnelle.
EXEMPLARITÉ ET DÉONTOLOGIE
L'exemplarité de l’enseignant ne vise pas la perfection mais une fidélité aux principes éthiques. Selon Eirick Prairat, cette exemplarité devrait être soutenue par un cadre déontologique clair, une sorte de charte publique de déontologie et un serment solennel d’entrée dans la profession.
- SYNTHÈSE
Au cours de la conférence du mercredi 22 mai 2024 sur CanoTech, Eirick Prairat propose un « parcours philosophique » dont le point de départ est l’estime de soi. Selon le philosophe Paul
Ricœur, l’estime de soi est liée à notre capacité d’agir. Elle se construit en estimant nos actes et actions. Nous nous estimons indirectement nous-mêmes en tant qu'auteurs de nos actions.
« Ce que je fais, cela seul est de moi », écrit le philosophe Alain dans Éléments de philosophie. L’estime de soi n’est pas l’estime de moi. Elle est inséparable de l’estime de l’autre ; ce que l’on estime en soi-même c'est notre propre humanité, qui n’est rien d’autre que notre humanité commune. Contrairement à ce que l’on peut entendre parfois, l’estime de soi n’a rien à voir avec l’égoïsme.
L’importance de l’école dans la construction de soi
Le lieu de la construction de l’estime de soi, c’est l’école. D’après Hegel, dans la famille l’enfant a une valeur parce qu’il est l’enfant. À l’école, l’enfant cesse de valoir à cause de sa personne,
il commence à valoir pour ce qu’il fait. L’école joue un rôle crucial dans la conquête de soi, en substituant le primat de l’identité par le primat de l’activité. L’estime de soi est une conquête qui requiert bien évidemment de croire en soi mais qui requiert plus fondamentalement l’appui d’un « allié éthique ». « Un autre, en comptant sur moi,
me rend responsable de mes actes » (Paul Ricoeur). On ne croit en soi que parce que quelqu’un d’autre croit déjà en nous. Cela nous amène à examiner toutes les implications éthiques pour
l’enseignant.
La vertu de justice
La première vertu du professeur, c’est la vertu de justice. Elle se décline de deux manières :
– en respectant l’élève comme sujet de droit, la légalité, les lois et les textes ;
– en respectant l’élève comme sujet apprenant et en faisant vivre la dialectique de l’égalité et de l’inégalité : l’égalité dans les attentes et les objectifs, l’inégalité dans les aides et accompagnements apportés à l’élève.
La justice ne se limite pas à l’évaluation, mais s'inscrit plus fondamentalement dans l’organisation même de l’acte d’enseigner.
Une éthique de la présence
La vertu majeure de justice doit être accompagnée de deux autres vertus pour que l’on puisse parler d’une présence éthique du professeur : la vertu de bienveillance et la vertu de tact. Mais,
avant de les détailler, Eirick Prairat revient sur cette notion de présence. La présence est d’abord un art d’être présent, à soi et aux autres, d’être attentif. C’est aussi un art d’être au
présent, ici et maintenant, dans l’immédiate actualité de ce qui se déploie : être disponible. C’est enfin un art du présent au sens du cadeau, de ce que l’on donne, ses connaissances, son
savoir-faire, son expérience. C’est une manière d’être, une manière d’habiter la classe. Emmanuel Lévinas dans Totalité et infini : « Le premier enseignement de l’enseignant, c’est sa présence même d’enseignant ».
La vertu de bienveillance
La bienveillance n’est pas la complaisance. Il ne s’agit pas de plaire mais de prendre soin, de prendre conscience de la fragilité et de la vulnérabilité de chaque individu. Le bienveillant
veille, il veille au bien-être. Un geste, un mot, un sourire peuvent suffire.
La vertu de tact
En écrivant La morale du professeur (Puf, 2013), Eirick Prairat a été frappé de l’importance donnée au tact dans les métiers du soin et de la médecine et de son absence quasi-totale dans
les métiers de l’enseignement. Qui se souvient de Johann Friedrich Herbart, professeur de pédagogie et de philosophie du début du XIXe siècle et premier philosophe à avoir fait une
place au tact dans la relation pédagogique ? Il a été oublié, comme le tact dans l’éducation. Le tact est une notion voisine de la civilité, mais il va au-delà des règles et des recommandations. II y a de l’improvisation dans le tact. C’est un sens de l’adresse et de l’à-propos :
– sens de l’adresse : quand je parle à Paul, je ne parle pas à Delphine et quand je parle à
Delphine, je ne parle pas à Mohamed ;
– sens de l’à-propos : ce que je vais dire, ne pas dire, la manière de le dire. C’est une vertu morale car il manifeste une sensibilité à autrui.
Justice, bienveillance, tact : l’éthique de l’enseignant doit nouer ces trois vertus. La justice est soucieuse du collectif, de l’équilibre, la bienveillance est attentive au sujet singulier et le tact
est le souci de la relation elle-même. L’exemplarité professorale relève de la fidélité à ces trois principes éthiques.
L’exemplarité dans l’éducation
Cette exemplarité n’est pas la recherche de la perfection. Comme l’écrit Rousseau (Émile, ou de l’éducation, Livre IV) : « Une autre erreur que j’ai déjà combattue, mais qui ne sortira jamais
des petits esprits, c’est d’affecter toujours la dignité magistrale, et de vouloir passer pour un homme parfait dans l’esprit de votre disciple. [...] Montrez vos faiblesses à votre élève, si vous
voulez le guérir des siennes : qu’il voie en vous les mêmes combats qu’il éprouve, qu’il apprenne à se vaincre à votre exemple. » La nécessaire exemplarité n’est pas du côté de l’héroïsme mais d’une fidélité silencieuse à quelques grands principes éthiques, ce qui rend un professeur respectable aux yeux de ses élèves. Cette éthique est fragile et vacillante, face à l’usure du temps et de la répétition. Pour se maintenir dans une constance éthique, Eirick Prairat propose de s’appuyer sur un cadre déontologique clair. Il milite pour une véritable charte publique de déontologie et une entrée solennelle dans le métier d’enseignant, ce que l'on pourrait appeler le « serment de Socrate ».
La déontologie professionnelle
Cette idée de déontologie fait l’objet de beaucoup d’incompréhensions. La déontologie professionnelle est un ensemble de normes et de recommandations auxquelles les
professionnels adhèrent pour mener leur mission de la meilleure manière possible. Pour Eirick Prairat, elle remplit trois grandes fonctions :
– une fonction identitaire, en définissant l’identité professionnelle ;
– une fonction d’engagement collectif, en fournissant des repères pour faciliter la décision et
l’action dans des contextes de travail complexes ;
– une fonction de moralisation des pratiques professionnelles, en condamnant les pratiques
douteuses, inacceptables ou illégitimes.
L’éthique enseignante n’est pas un supplément d’âme ; elle se trouve au cœur du professionnalisme enseignant. À ce titre, Eirick Prairat donne des pistes pour la formation éthique des professeurs. Elle devrait reposer sur trois piliers :
– travailler à partir d’exemples ;
– travailler sur des dilemmes moraux et éthiques ;
– mettre en mots les moments les plus quotidiens de la vie professorale.
Source : CanoTech (Réseau Canopé)
Jean-Baptiste Touja
Nombre d'articles: 1
Voir tous les articles